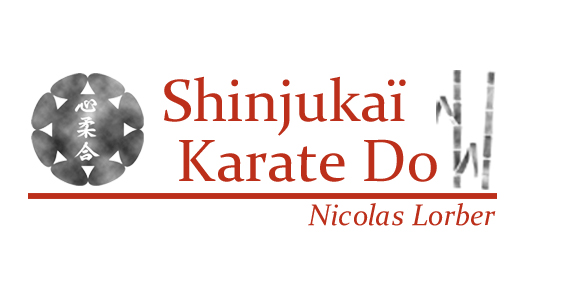Récemment, la Fédération Française de Karaté à publié sur son site un article de Zenei Oshiro en trois parties sur les racines du Karaté.
Je suis content de voir ce genre d’article sur le site de la Fédération qui est aujourd’hui à mon gout trop sportive. Je regrette cependant que ce genre d’article ne soit pas plus fréquent et affiché de manière permanente et accessible, autrement que lors de son bref passage dans les « actualités ».
Mais j’avais prévu une copie 😉 que voici:

Oshiro Sensei est l’un des plus fins connaisseurs de ce karaté traditionnel issu de la petite île du pacifique perdue entre la Chine et le Japon, Okinawa. Une île où les puissants installaient des châteaux ou des comptoirs commerciaux, où le karaté servait à se défendre ou à affirmer sa réputation de combattant et dont le savoir allait se chercher au-delà des eaux et se transmettait comme un savoir secret. Partons avec lui à la découverte des origines de notre art, faisons le voyage d’Okinawa.
Première partie : le Shuri-Te, à l’origine du Shotokan
Bien sûr, les arts martiaux d’Okinawa, le karaté originel, a des racines lointaines, mais elles se mêlent aux légendes qu’on a colporté pendant des siècles, aux histoires qu’on a raconté sur le sujet. En fait, on n’en sait pas grand chose ! Ainsi on raconte qu’au 14e siècle, trente-six familles chinoises se sont installées dans un quartier d’Okinawa pour le commerce et y pratiquaient les arts martiaux. Ces arts martiaux auraient progressivement influencé les combattants des alentours… Cela dit bien qu’il y a des origines chinoises au karaté d’Okinawa, mais cela ne nous aide pas vraiment à savoir de quoi il était question, ce qu’ils pratiquaient. On les disait originaire de la province de Fukien (ou Fujian), une province du Sud à la hauteur de Taiwan, qui est à 200 km à peu près d’Okinawa. C’est cette influence qui va donner le style de Naha, dont nous reparlerons.
SAKUGAWA SHUNGO, LE PREMIER ENSEIGNANT DE TO-DE
C’est au XIXe siècle qu’on entre vraiment dans la période historique. Le premier grand expert de Shuri-Te est Sakugawa Shungo, dont l’un des maîtres aurait été un expert chinois nommé Ku-Shan-Ku, qui lui aurait enseigné la Boxe Chinoise. Sakugawa est mort en 1815, ce qui fait de lui un homme du XVIIIe siècle, et on ne connaît pas grand chose de lui, sinon qu’il était probablement de classe populaire et fut élevé au rang de serviteur du roi d’Okinawa. Il eut l’occasion de voyager en Chine pour son art. L’un de ses élèves fut Matsumura Sokon, lequel aura pour élèves Azato Yasuzato et Itosu Yasutsune, qui seront les deux professeurs de Gichin Funakoshi, le fondateur du karaté Shotokan.
L’INFLUENCE DÉCISIVE DU JIGEN-RYU
Matsumura Sokon a une dizaine d’années quand il est présenté à Sakugawa, expert déjà âgé de boxe chinoise, on disait aussi To-de, « main des Tang », qui vivait dans le village de Shuri. Aujourd’hui Shuri est encore un quartier de la ville de Naha, qui a tout englobé, mais à l’époque c’est la capitale royale d’Okinawa. Matsumura aura bientôt une réputation importante et il entre au service des derniers rois d’Okinawa comme probable instructeur de techniques martiales. Il épousera une femme descendante d’une lignée d’experts martiaux, laquelle dit-on aurait influencé la mise au point du kata Useishi, futur Gojushiho. Avec son statut, il voyage en Chine et au Japon, dans le clan des Shimazu de la province de Satsuma, réputé pour ses arts guerriers, qui fut chargé de la conquête d’Okinawa. C’est à cette occasion que Matsumara Sokon est initié à l’art du sabre des Shimazu, de l’école Jigen-Ryu. Cette école se caractérise par un fort esprit d’attaque qui place l’efficacité dans une stratégie où il faut en finir sur un seul coup en comblant rapidement la distance et beaucoup d’importance placée dans la préparation physique et mentale. C’est sans doute cette influence qui donnera au « Shuri-Te » son caractère particulier, qu’il conservera dans le principe « un coup, une vie » propre au karaté Shotokan, et qu’on ne retrouve pas dans le Goju-Ryu par exemple où il faut enchaîner les attaques.
MATSUMARA, LE PÈRE DE L’OKINAWA-TE
Matsumura est devenu un proche du roi. Il était intelligent et lettré et son expertise dans le combat était considérée comme précieuse. La transmission est rare à ce moment-là. On n’enseigne pas comme aujourd’hui avec beaucoup d’élèves et pour des raisons commerciales. On choisit cinq ou six élèves qui sont des disciples, des continuateurs. Matsumura est un personnage considérable, déjà un réformateur et un concepteur, le père de l’Okinawa-Te de façon globale et il aura pour sa part un nombre assez important d’élèves.
Les deux plus connus de notre époque moderne furent Azato Yasuzato, dit Azato Anko, et Itosu Yasutsune, dit Anko lui aussi. Azato était d’une famille aisée et commença la pratique avec Matsumura vers ses dix-huit ans et devint lui aussi adepte de la Jigen-Ryu, comme d’autres arts samouraïs, l’équitation ou le tir à l’arc. Il fut le continuateur du style de Matsumura et de son esprit, avec l’accent mis sur le coup unique, comme un coup de sabre. On ne lui connaît à peu près que deux élèves, dont Gichin Funakoshi, qui a raconté le type d’apprentissage auquel il était soumis, avec des rendez-vous secrets nocturnes, beaucoup de répétions et l’accent mis sur un kata pendant trois ans minimum.
ITOSU, LE GRAND DIFFUSEUR DE L’ECOLE DE SHURI
Itosu Yasutsune, dit Anko (le cheval de fer) est plus connu que son ami Azato. Célèbre comme combattant, c’est aussi lui qui a initié la transformation du karaté qu’il avait appris en système éducatif pour la jeunesse et sportif. Né à Shuri, c’est à 16 ans qu’il a commencé à être enseigné par Matsumura. Lettré en chinois et en japonais, Itosu prit des fonctions à la cour du roi et continua à approfondir son art auprès de nombreux experts. Sa réputation de grand combattant à la force exceptionnelle est légendaire. C’est vers cinquante ans passés, en 1885, qu’il a commencé à enseigner ce qu’il savait, influençant par ses leçons la plupart des experts de l’époque. Il fut l’artisan de la démocratisation du karaté qu’il souhaitait voir enseigner dans les écoles d’Okinawa dans une forme simplifiée et codifiée. Le karaté est encore fermé, un secret à défendre, il l’ouvre à tout le monde, proposant une version éducative de cet art de combat. Il fixe les modalités d’entraînement dans un esprit nouveau. C’est pour les étudiants qu’il crée les cinq kata Pinan à partir de Kushanku. Il meurt en 1916, l’année même ou Gichin Funakoshi est appelé au Japon pour faire sa première démonstration devant le Butokuden de Kyoto.
LE SHOTOKAN CONQUIERT LE MONDE EN S’INSPIRANT DU KENDO
Gichin Funakoshi commença à 15 ans la pratique du karaté avec maître Azato comme une discipline à transmettre en secret, lors d’entraînements nocturnes. À ses trente ans, elle était diffusée dans les écoles d’Okinawa et la première démonstration publique avait été organisée sous l’influence de son second professeur, maître Itosu. Diplômé et instruit, Il eut la mission de se rendre au Japon pour une grande exposition nationale où toutes les provinces étaient appelées à montrer quelque chose d’elle-même. Il parle japonais, ce qui n’est pas fréquent à l’époque pour un Okinawaiien et séduit des personnalités importantes de l’époque au Japon, notamment le créateur du judo, Jigoro Kano, qui va l’encourager à créer son dojo. Ce sera le « Shotokan », la Maison de Shoto – le nom de plume de ce fin lettré qui écrit des poèmes – à Tokyo, qui va progressivement devenir une école, puis un système sportif à la mort de Funakoshi. Si Gichin Funakoshi enseigne un Shuri-Te classique dans la continuité de ses maîtres, ce sont ses continuateurs, et notamment son fils Yoshitaka, qui vont fixer pour l’avenir les éléments du style, et notamment la forme de compétition. Elle va suivre l’esprit originel du « Shuri-Te », mais elle est conçue aussi pour se distinguer de la boxe. La forme de compétition « Shotokan » s’inspire des compétitions de Kendo, choisissant de valoriser les attaques de loin, sur un coup, comme une attaque de sabre. La dimension des clés, des saisies, est éliminée de la forme sportive qui naît à ce moment-là et qui se prépare à conquérir le monde. Le karaté – sous cette forme – n’est plus tout à fait un système de défense, même si de nombreux aspects sont préservés dans l’entraînement et qu’on les retrouve aujourd’hui dans la recherche du karaté–jutsu. En Shotokan, c’est l’esprit du sabre de Shuri qui l’emporte.
En revanche, l’élève japonais de Gichin Funakoshi, Otsuka Hironori par ailleurs déjà expert de haut niveau en jujutsu, revient à des postures plus naturelles et plus hautes, des placements plus rapprochés de l’adversaire, remettant au centre les questions de fluidité et d’enchaînement, ainsi que les techniques de clés et de projection. Il prend ses distances avec Gichin Funakoshi et son fils pour fonder le Wado-Ryu.
À OKINAWA, LE SHURI-TE D’AUJOURD’HUI
À Okinawa aujourd’hui, l’histoire de la conquête du Japon, puis du monde, par le karaté « Shotokan » de Funakoshi n’est pas très racontée. Certains lui reprochent encore d’avoir donné le karaté aux Japonais ! Le Shotokan n’a guère de popularité dans l’île et on ne le retrouve que dans un ou deux dojos. Le style héritier du Shuri-Te est le Shorin-Ryu (École Shaolin), qui propose un karaté à distance plus rapprochée que le Shotokan, avec des postures plus hautes, des positions plus naturelles et des mouvements plus courts qui privilégient la vitesse d’exécution. Le Shorin-ryu est sans doute le style général le plus pratiqué à Okinawa. Dans la sphère « Shorin », on retrouve le Kobayashi-Ryu de Chibana Choshin, élève direct d’Itosu, qui aura plus tard comme représentants les maîtres Higa, Nakazato, Miyahira. On retrouve aussi Mastsubayashi-Ryu de maître Nagamine, élève de Chibana et la Shukunai Hayashi-Ryu de Kyan Chotoku, élève de Matsumura et d’Itosu, mais aussi d’experts du Tomari-Te. À chaque génération, les nouveaux dojos, les variantes d’école et les fédérations diverses se font plus nombreuses et complexes.
Deuxième partie : le Naha-Te, les racines chinoises du karaté
Rappelons cette histoire semi légendaire des trente-six familles chinoises réunies dans ce village de Kume, en périphérie de Naha à l’époque. Ce serait en 1393 qu’un empereur chinois envoya ses premiers émissaires vers Okinawa pour demander un tribut. Ce sont des diplomates, des marchands, des experts de toutes sortes qui diffusent la culture chinoise. On trouve encore la trace de manifestations publiques des gens de Kume effectuées au XIXe siècle. C’est là que commence l’histoire du Naha-Te.
Naha ? Aujourd’hui, c’est la ville principale d’Okinawa. Shuri et Tomari ont été englobés dans ce tissu urbain et n’en sont plus que des quartiers. Mais à l’époque, ces bourgades sont distinctes les unes des autres, mais très proches en termes de distance. C’est étonnant aujourd’hui de penser que Shuri est à peine à huit kilomètres de Naha, et que le village de Tomari est entre les deux ! Pourtant, les trois grandes influences originelles du karaté d’Okinawa tiennent dans ce mouchoir de poche. Il faut penser que dans un monde sans voiture, et même sans chevaux, comme Okinawa à l’époque, si sept ou huit kilomètres sont faisables en quelques heures de marche, on ne fait pas ça tous les jours. Si proches… mais déjà assez loin quand on marche à pied !
Shuri était la capitale royale, Naha et Tomari sont les deux villages portuaires, où se font les échanges commerciaux. Déjà la mentalité n’est pas la même et les experts sont un peu différents à ce niveau. A Shuri, on pratique le To-De pour des raisons de prestige social et pour obtenir une charge honorifique à la cour royale. À Naha, c’est une aventure plus personnelle, liée aussi aux voyages commerciaux, à la découverte de soi et des mystères de la Chine, une relation qui fait sa spécificité.
L’histoire du Naha-Te prend ses racines au XIVe siècle, mais sa naissance historique est, comme celle du Shuri-Te, une aventure du XIXe siècle.
HIGAONNA, UN RÉFORMATEUR
Né à Naha Higaonna Kanryo commence la pratique du combat à la façon de Kume avec un expert nommé Aragaki Seisho, un homme qui parle chinois et finira par retourner en Chine. C’est muni de ces bases solides en boxe chinoise que le jeune homme part lui-même en Chine à la découverte des secrets du combat. Il fait probablement du commerce entre l’île et le continent. Il serait resté plus de dix ans, rencontrant de nombreux maîtres, apprenant la Grue Blanche et de très nombreux katas dont le karaté a gardé la trace, comme Sanchin, Seyonchin, Shisochin, Seisan, Sanseru, Kururunfa ou encore Suparinpei.
C’est entre trente et quarante ans qu’il revient à Okinawa et ouvrit un dojo d’abord confidentiel, enseignant notamment la position Sanchin-dachi, sur laquelle il était lui-même indéracinable dit la légende.
Contemporain d’Itosu – il mourra la même année, en 1916 – Higaonna va, comme lui, rompre avec les habitudes de secret et enseigner à beaucoup de monde, y compris dans les établissements scolaires et les dojos de la police. Il aurait sans doute aussi volontairement édulcoré certains aspects de son système de « Naha-Te » pour le rendre plus attractif et accessible. C’est autour du kata Sanchin, qui incarne le cœur du Naha-Te et des styles qui ont suivi, que se repèrent les modifications apportées, puis corrigées, ou pas, par les autres générations. Comme le Shuri-te est réuni dans l’appellation générale de Shorin-Ryu, le Naha-Te et tous les styles proches sont regroupés dans l’appelation Shorei-Ryu… qui veut dire la même chose (École de Shaolin).
Le « Naha-Te » d’Higaonna était dynamique, avec des coups de pied rapides et beaucoup de déplacements. Si il est manifeste qu’il avait appris Sanchin mains ouvertes, il le transmit à la plupart de ses élèves poings fermés et avec un mode de respiration plus courte et fluide, sur un rythme plus rapide. Le style a beaucoup évolué sous l’influence de son principal élève Miyagi Chojun, fondateur du Goju-Ryu qui donnera, entre autres, les caractéristiques actuelles du kata Sanchin : contraction constante, respiration sonore et forcée en inspiration comme à l’expiration.
« TOUT DANS L’UNIVERS RESPIRE DUR ET SOUPLE »
Contrairement à Higaonna, Miyagi Chojun est d’une famille aisée, possédant des navires de commerce et essaimant jusqu’à Hawaii. S’il apprend avec Higaonna, Miyagi va entamer un retour aux sources du Naha-Te en faisant le voyage vers la Chine sur les traces des professeurs de son maître. C’est ainsi qu’il fut amené à modifier le kata Sanchin et à créer un second kata « respiratoire », Tensho, plus complexe au niveau des mouvements et alternant le souple et le dur sur la base d’un kata non transmis par Higaonna. C’est ce karaté, préoccupé de maîtrise posturale statique et forte, de contrôle respiratoire dans l’esprit chinois du Qi-Qong, resté proche des préoccupations originelles du combat rapproché contre plusieurs adversaires potentiels et un risque mortel, avec le patrimoine des clés et des projections, des techniques de poing courtes et rondes, des coups de pied bas, que Miyagi Chojun finira par appeler Goju-Ryu (Ecole du Dur-souple). Une marque encore de l’influence chinoise sur cette lignée de karaté. C’est une allusion à une phrase du Bubishi, célèbre ouvrage chinois sur le combat : « Tout dans l’Univers respire dur et souple ».
Miyagi Chojun, personnage lui aussi devenu légendaire et célèbre, fera la rencontre de Jigoro Kano et le parcours vers le Japon, où il diffusera son art parallèlement au Shotokan de Funakoshi. Il aura pour élève le Japonais Yamaguchi Gogen, qui popularisera la branche japonaise du Goju-Ryu, faisant de son école un creuset pour les valeurs traditionnelles japonaises en pleine période d’occupation américaine.
Si le Goju-Ryu a lui aussi suivi une logique d’ouverture au plus grand nombre et fut progressivement organisé pour être enseigné aux étudiants en masse, mais aussi pour faire face aux enjeux sportifs, modifiant ainsi progressivement, mais radicalement l’esprit originel, il conserve toujours un courant de pensée plus radicale à la recherche du concept d’efficacité martiale. Parmi les styles héritiers du Goju-Ryu on trouve en effet les styles « sportifs » de plein contact, comme le Kyokushinkai de Masutatsu Oyama. À Okinawa, ce sont les maîtres Higa Seiko, Yagi Meitoku, Eiichi Miyazato qui furent les continuateurs officiels de Myagi Chojun, jusqu’à la fin du XXe siècle.
UECHI-RYU, PLUS CHINOIS ENCORE !
Kambun Uechi est un homme de la campagne. C’était le fils d’un ancien samouraï devenu fermier au moment de l’entrée dans l’Ère Meiji, installé dans le village de Motobu, au nord d’Okinawa. Il part en Chine en 1897, dans cette province de Fukien (Fujian) en face d’Okinawa fréquenté par tous les aspirants okinawaiens à la connaissance, probablement pour échapper à la conscription dans l’armée japonaise, et comme Higaonna notamment, à la recherche de l’art du combat. Il y restera plus de dix ans, s’écartant des sentiers battus par les autres experts d’Okinawa pour devenir l’aide et le disciple d’un herboriste chinois qui lui apprend le style Pangai-noon, aujourd’hui disparu en Chine, et qui veut dire à peu près la même chose que go-ju : dur – doux. Revenu en 1910 à Okinawa, il se consacre à la propriété familiale, refusant d’enseigner son art. Peut-être pour passer inaperçu auprès des autorités (il est déserteur), mais aussi, dit la légende parce que lui, ou un de ses élèves chinois, aurait tué un homme dans une rixe. Mais son expertise finit par se remarquer et les élèves potentiels insistent. Itosu le voit faire une démonstration du kata Sanchin, qu’il pratique mains ouvertes selon des modalités plus traditionnelles, et lui demande de faire partie des professeurs officiels de l’Okinawa-Te, la fédération de tous les styles de l’île. À sa mort cependant, Kambun Uechi prend ses distances. Il finira par aller à Nagoya au Japon travailler dans une usine textile, enseignant là aussi avec discrétion à la communauté okinawaienne. Ce n’est qu’en 1940 qu’il commence à prendre plus d’élèves et change le nom du style en « Uechi-Ryu ». Il rentre à Okinawa en 1946 et meurt deux ans plus tard. Bien que n’étant pas à proprement parler de l’influence du Naha-Te, le Uechi-Ryu puise aux mêmes sources et peut-être encore plus profondément. Il est considéré à Okinawa comme une boxe chinoise, proche de ses origines martiales. Il est plus rude, plus direct, plus explosif que le Goju-Ryu. Les postures poings fermés sont rares et il privilégie le corps à corps avec des attaques de jambe basse avec la pointe des orteils. Le renforcement du corps par les exercices traditionnels en est une base essentielle du style qui a pour objet de faire du corps une arme. Sous l’influence de la boxe thaïlandaise, les écoles modernes renforcent aussi les jambes, ce qui n’était pas le cas au départ.
Au Japon comme à Okinawa, où fut implanté le Hombu Dojo du style, fréquenté par beaucoup d’étrangers notamment américain, c’est son fils Kanei Uechi, qui fut le principal organisateur et codificateur de l’école Uechi-Ryu. Le fameux Kiyohide Shinjo, actuel 9e dan de karaté, invaincu en compétition à Okinawa pendant neuf ans et surnommé le « Superman d’Okinawa », est l’un des grands continuateurs du Uechi-Ryu sur l’île.
Troisième partie : le Tomari-Te, à la source du Kata Unsu
Zenei Oshiro, 8e dan Karaté goju-ryu et Kobudo • © Denis Boulanger / FFKDAComme je vous le disais à propos du Naha-Te, si toutes ces influences ont eu des trajectoires mondiales, à la base, ce sont trois villages d’Okinawa, trois petites communautés qui tiennent dans un cercle de moins de 10km. Ainsi le village de Tomari est à moins de quatre kilomètres de Kume, le village « chinois » de Naha. Mais nous parlons d’une époque où le secret est de mise et, d’un dojo à l’autre, d’un maître à l’autre, d’un village à l’autre, chacun cultive sa différence, essentielle à ses yeux. Au XIXe siècle, le Tomari-Te est donc un style à part, initié à cette époque par un homme en particulier Kosaku Matsumora, qui sera l’un des professeurs de Chotoku Kyan, mais aussi de Choki Motobu.
MATSUMORA, LE MAÎTRE DE TOMARI
Kosaku Matsumora avait appris la boxe chinoise, mais aussi des techniques de bâton issues du Jigen-Ryu, si important dans l’influence du Shuri-Te. Bien que très marqué par l’esprit et de Shuri, le Tomari-Te a des katas originaux et certains qui portent le même nom, mais sont très différents dans l’exécution. On doit à cette sphère technique, entre autres, les kata Sochin et… Unsu, avec ses mawashi donnés à partir du sol ! On a souvent taxé péjorativement (notamment du côté des aristocrates de Shuri) le style Tomari de « paysan », sans doute parce qu’il ne bénéficiait de l’aura, ni de la cour royale de Shuri et du clan de Satsuma, ni de l’influence culturelle et technique des Chinois de Naha. Et aussi parce qu’il emprunte des formes proches des danses traditionnelles qui se mêlent aux gestes purement martiaux. À la fois pour masquer les techniques aux yeux indiscrets, selon une technique universelle, et aussi sans doute parce que dans les petites communautés rurales tout finit par des chants et des danses.
LES TURBULENTS DU TOMARI-TE
Mais Kyan Chotoku et Choki Motobu sont passés à la postérité comme des combattants aguerris réputés. Kyan Chotoku était le fils d’un noble Okinawaien de Shuri. Jeune, il fut l’élève de Matsumura et d’Itosu pour le Shuri-Te, mais aussi des maîtres du Tomari, dont Kosaku Matsumora. Il accompagna son père en exil au Japon et continua son apprentissage. De retour à trente ans, il possédait les katas Seisan, Naihanchi, Gojushiho issus du Shuri-Te, mais aussi Kushanku, Passai, Wanshu (Empi), Chinto (Gankaku), Ananku, qu’il mit au point à partir de l’enseignement d’un expert de Taiwan, Tokumine-no-kon, un kata de bâton. Vif, célèbres pour ses esquives et son karaté rapide, Kyan Chotoku eut aussi une réputation de turbulent tirant le diable par la queue et souvent dans les mauvais coups. Il aurait même tué un autre expert dans un duel à mains nues.
Quant à Choki Motobu, il a laissé le souvenir d’un combattant né, à la réputation exécrable. Apprenant de chacun de quoi développer les quelques éléments qu’il avait surpris de l’art de son père, un expert qui n’avait pas souhaité enseigner son cadet, volontaire et fort, mais aussi agressif, grossier, peu contrôlable ! Personne ne voulait de lui dans son dojo et il passait de l’un à l’autre. C’est finalement Kosaku Matsumora qui l’accueillit le plus longtemps et c’est pourquoi le style tout personnel de Motobu est lié par ce biais au Tomari-Te. Motobu fit de nombreux combats à Okinawa comme au Japon où il resta jusqu’en 1938, gagnant la plupart d’entre eux dans un style très dur, enraciné en naihanchi-dachi, mais capable d’esquives rapides, encaissant les frappes sans difficulté grâce à sa puissance naturelle entretenue par la musculation et attaquant pour obtenir le KO, notamment avec le poing dragon (keiko-ken), avec une phalange sortie, son coup favori. Il est mort en 1940 sans postérité, mais laissant une empreinte durable par son parcours et son style très personnel.
À l’entrée du XXe siècle, avec les échanges de plus en plus fréquents, le Tomari-Te, a fini par se fondre dans la nébuleuse « Shorin-Ryu », même si des experts comme Nakashone et Kokashiki, maître de Goju-Ryu, en sont aussi des continuateurs, encore marqué par les racines spécifiques de cette branche du karaté.
SHITO-RYU, LA SYNTHÈSE DE MABUNI
Je ne devrais pas vous parler du Shito-Ryu dans cet article consacré à l’influence de Tomari, car il n’a rien à voir avec Matsumora et les experts de Tomari. Mais comme le style de Tomari, le Shito-Ryu a subi les influences de Shuri-Te et celle de la Chine à travers Naha. C’est Kenwa Mabuni, qui va en être le créateur. Né à la fin du XIXe siècle à Shuri, il entame sa formation par le Shuri-Te du maître Itosu. C’est son amitié avec Myagi Chojun, le créateur du Goju-Ryu, qui lui vaut son entrée dans l’École de Police d’Okinawa, quelques temps après son introduction auprès du maître emblématique du Naha-Te, Kanryo Higaonna. Son statut d’inspecteur de Police lui offre la possibilité de s’entraîner régulièrement et avec de nombreux experts, ce qui lui permet non seulement de faire le lien entre les deux grandes influences de Shuri et de Naha, avec l’apprentissage de la Grue Blanche de la fameuse province de Fukien (Fujian), mais aussi de maîtriser le kobudo d’Okinawa avec divers enseignants. Après dix ans dans la police, il finit par fonder son dojo, puis fit le voyage vers le Japon lui aussi en 1926, à Osaka, enseignant dans les universités son art de l’Okinawa-te et le Kobudo. Son école devenant populaire, il finit par la nommer « Shito-Ryu », en hommage à ses deux influences majeures et à ses deux maîtres, Itosu et Higaonna (car les idéogrammes Ito e Higa peuvent se lire Shi et To).
Logiquement, le Shito-Ryu se caractérise par de nombreux katas, dont une bonne part de ceux qui fondent aujourd’hui le Goju-Ryu, héritier de Naha. Les kobudo sont une marque majeure du style, encore aujourd’hui. La réussite du Shito-Ryu au Japon et dans son système universitaire, a marqué le Shito-Ryu qui s’est adapté notamment aux formes sportives qui ont participé à l’essor national et mondial du karaté et de ses trois racines okinawaiiennes, les villages de Shuri, Naha et Tomari.
UN MONDE QUI CONTINUE D’ÉVOLUER
D’une façon évidente, la grande transformation du XXe siècle qui a fait de ces arts secrets qu’on ne transmettait qu’à un disciple choisi de grands projets régionaux, à la fois éducatifs et identitaires, pour former la population à travers une pratique du crû, mais aussi valoriser l’image d’Okinawa, puis du Japon, a très largement modifié la forme et l’esprit de ces pratiques. La transmission du karaté, dans ces décennies de grande diffusion, se caractérise par l’organisation d’entraînements de masse à plusieurs centaines d’étudiants, qui demandent une technique linéaire, voire rudimentaire, et des exercices à deux extrêmement codifiés.
De même la compétition internationale a imprimé sa marque sur cette histoire, modifiant les styles, et continuant à créer son propre cheminement, un nouveau sillon pour le karaté. Ainsi, par exemple, le style obscur Ryuei-Ryu est devenu l’un des styles officiels de l’Okiwana-Te, parce que son leader actuel Tsuguo Sakamoto est devenu trois fois champion du monde dans les années 80 avec le kata Anan, trésor caché de ce style ! Ce kata alors presque inconnu qui se prête si bien à la compétition est devenu « star », et il a été repris par deux nombreux techniciens venus de styles divers. De la province de Fukien, en passant par Shuri, Naha et Tomari, le karaté a fait du chemin.